Depuis les élections européennes de 2024, un fossé béant s’élargit entre l’Europe institutionnelle, celle des commissaires, des juges et des technocrates bruxellois, et l’Europe réelle, celle des peuples qui travaillent, élèvent leurs enfants et peinent à reconnaître leur propre voix dans les décisions prises en leur nom.
L’une parle de “valeurs” et de “progrès”, l’autre réclame souveraineté, sécurité et respect de ses traditions. Entre les deux, la fracture devient un abîme.
Un exemple récent illustre parfaitement ce divorce : l’élection présidentielle irlandaise, qui s’est déroulée dans une indifférence mêlée de colère populaire. Officiellement, la candidate soutenue par la gauche et par le Sinn Féin a remporté un “triomphe historique”. En réalité, le scrutin a révélé un désaveu massif du système politique dans son ensemble.
L’Irlande, miroir d’une crise démocratique
Catherine Connolly, élue présidente avec plus de 60 % des suffrages exprimés, a été célébrée comme une figure “anti-establishment”. Mais derrière cette victoire apparente se cache un chiffre autrement plus révélateur : 13 % des bulletins de vote ont été volontairement annulés ou détériorés.
Un record historique, dix fois supérieur à celui du précédent scrutin.
Ces votes n’étaient pas des erreurs : ils traduisaient une colère organisée et consciente.
Sur les réseaux sociaux, de nombreux Irlandais appelaient à “voter blanc autrement”, en barrant tous les noms ou en inscrivant sur leur bulletin des messages de défiance tels que “Pas de démocratie”, “Marionnettes de l’UE” ou encore “Aucun de ceux-là”.
Dans certaines circonscriptions populaires de Dublin, plus d’un électeur sur cinq a choisi de rejeter purement et simplement tous les candidats.
Ce phénomène, que les médias locaux ont tenté de minimiser, révèle une fracture profonde : celle entre un peuple dépossédé de sa parole et une élite politique déconnectée, même au sein de partis se réclamant du “changement” comme le Sinn Féin.
Une colère populaire sans débouché politique
L’Irlande, longtemps perçue comme un bastion stable du libéralisme européen, entre à son tour dans la zone de turbulence.
La colère des électeurs ne s’exprime pas seulement dans les urnes : elle gronde dans les rues de Dublin, où des émeutes sporadiques ont éclaté après des affaires impliquant des migrants logés par l’État.
Les autorités réagissent par le mépris ou la répression, qualifiant de “racistes” ou “extrémistes” ceux qui critiquent la politique migratoire du gouvernement.
Résultat : une majorité silencieuse se détourne du vote, faute d’alternative crédible, tandis qu’une minorité plus déterminée s’organise pour manifester son rejet.
Ce rejet, bien qu’encore diffus, a valeur d’avertissement.
Ce n’est pas l’adhésion au populisme qui grandit, mais le refus collectif d’un système politique perçu comme verrouillé.
Le faux discours de la “reculade démocratique”
Face à cette défiance généralisée, les dirigeants européens évoquent une “crise de la démocratie” ou un “recul démocratique”.
Mais ce vocabulaire technocratique dissimule mal la réalité : les peuples ne se détournent pas de la démocratie, ils se détournent de ceux qui prétendent la représenter.
Les citoyens ne croient plus aux élites qui leur expliquent, d’un ton professoral, comment ils doivent voter pour “le bien commun” — tout en fermant les frontières du débat sur l’immigration, l’énergie, ou la souveraineté nationale.
Ce double discours — défendre la démocratie tout en en excluant le peuple — mine la légitimité des institutions européennes.
Partout, des mouvements populaires émergent, portés par des électeurs qui ne se reconnaissent plus ni dans la gauche progressiste, ni dans les partis centristes au pouvoir depuis des décennies.
De Berlin à Rome, de Paris à Dublin, une même lassitude s’exprime : celle d’un continent fatigué d’être gouverné sans son consentement.
L’Europe des peuples contre l’Europe des élites
Ce qui se joue aujourd’hui dépasse le cas irlandais.
C’est la lutte entre deux conceptions de la démocratie : celle du demos — le peuple — et celle du kratos — le pouvoir.
Les élites veulent maintenir leur contrôle au nom d’une “stabilité” devenue synonyme d’immobilisme.
Les peuples, eux, réclament d’être à nouveau maîtres de leur destin.
L’“Europe officielle”, celle de Bruxelles et de ses commissaires, n’a pas encore perdu la main.
Mais le vent tourne.
Quand des citoyens préfèrent rayer les bulletins plutôt que de cautionner un choix imposé, quand ils écrivent “Aucun de vous ne me représente” sur leur vote, cela signifie que la légitimité du pouvoir est déjà fissurée.
L’avenir politique du continent ne se décidera peut-être pas dans les couloirs feutrés des institutions, mais dans les urnes désertées, les rues mécontentes et les campagnes oubliées. Et c’est là que renaîtra peut-être la vraie Europe — celle des nations, des traditions et des peuples qui refusent de se taire.
YV
Illustration : Pixabay (cc)
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



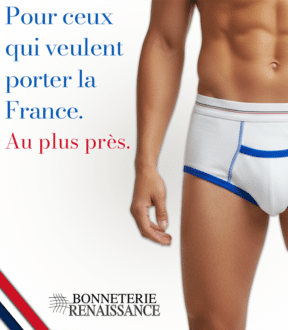


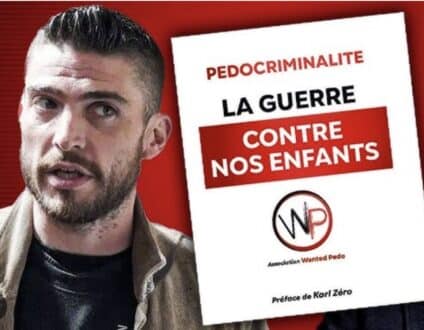


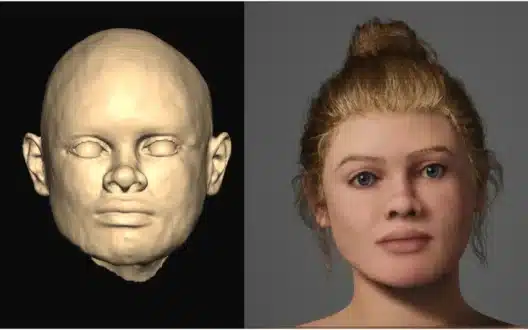



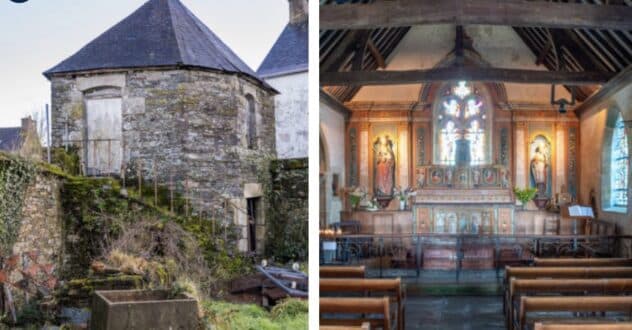

3 réponses à “Europe : la révolte silencieuse des urnes – quand le peuple ne se reconnaît plus dans ses dirigeants”
Exact, mais le mal est en fait encore plus profond, c’est la nature même de la démocratie représentative d’être tyrannique. La démocratie représentative n’est pas la sélection du plus sage, mais la sélection du plus séduisant, et donc très souvent du plus pervers, auquel on donne un pouvoir quasi illimité. La vraie démocratie est celle dans laquelle les décisions à caractère législatif et réglementaire sont prises par référendum / votation et la seule exécution des décisions est confiée aux dirigeants dont le principe de choix est presqu’indifférent, si ce n’est qu’il serait souhaitable de choisir des gens sages et de préférence préparés à ces fonctions.
La démocratie? Ah ça existe? Souvenez-vous d’un général dit Vendémiaire depuis écrasant la volonté populaire sous le feu des canons à la demande de l’Exécutif, souvenez-vous du diablotin grimaçant actuellement à la Santé ne respectant pas le résultat du référendum, souvenez-vous des bidouillages des élections présidentielles en Roumanie…des menaces à peine voilées de l’ex-Commissaire européen Breton
si les résultats ne conviennent pas à l’Europe donc dernière aux ordures de Davos gare à vous!
Toute la dictature de l’U.E repose sur une escroquerie, toutes les preuves sont là, et nos gouvernants fabriquent une guerre contre la Russie pour pouvoir envoyer l’Otan contre elle. L’Europe avait promis paix, prospérité et démocratie –