Je me trouvais ce matin à la Pointe de Léchiagat, assis à la terrasse du bar des Brisants. Le ciel, bas et lourd, pesait sur la mer grise. Un froid piquant pour la saison me força bientôt à rentrer, et je m’installai près du comptoir, face à la baie vitrée embuée. C’est là que je me plongeai dans la lecture du blog de Richard North, Turbulent Times. L’auteur, observateur aigu des convulsions britanniques, pose une question qui mérite attention : que fera Tommy Robinson de son succès populaire ?
North note avec justesse l’étrangeté d’un tel personnage. « La chose curieuse avec Tommy Robinson, écrit-il, c’est que malgré son audience considérable, il ne semble jamais avoir été tenté de créer un parti politique et de se présenter aux élections. » En d’autres termes, malgré son influence réelle, Robinson n’a pas choisi la voie parlementaire, préférant l’agitation des rues, les rassemblements et les marches. Cette abstention étonne, car la logique des chiffres jouerait en sa faveur. North calcule qu’« pour chaque personne présente à un rassemblement, il y en a dix autres en retrait. Sur la base de la participation au récent Unite the Kingdom Rally, Robinson pourrait donc compter sur 2,5 à 3 millions de voix s’il lançait un parti politique ».
L’obstacle est connu : comme l’Ukip jadis, une telle formation obtiendrait sans doute des millions de suffrages éparpillés sans réussir à conquérir de sièges. À quoi s’ajoute l’aspect prosaïque de la vie politique, « créer des sections locales, désigner des candidats et élaborer des programmes », dont Robinson, activiste instinctif, ne paraît guère friand. Pourtant, souligne North, « s’il lançait un parti, il partirait avec un avantage considérable, balayant sans peine l’effort de Ben Habib, écrasant les groupuscules tels que Homeland, réduisant l’Ukip en cendres et menaçant Farage lui-même ».
Le parallèle entre Farage et Robinson éclaire cette énigme. L’un, tribun madré, a su transformer la révolte anti-européenne en capital politique tangible. L’autre, autodidacte rageur, canalise une colère diffuse mais reste en dehors du système. North le formule d’un trait : Robinson accomplit « le gros du travail dans les rues », il attise les passions, mobilise les foules, tandis que Farage, prudemment en retrait, « récolte la gloire par ricochet ». Le premier expose son corps aux huées et aux matraques, le second encaisse les bénéfices électoraux. Double itinéraire qui rappelle les duos contradictoires de l’histoire, où l’agitateur prépare le terrain que le politicien récolte.
Cette dialectique n’est pas étrangère aux Français. Nous avons, nous aussi, notre couple antagoniste, dans la personne d’Éric Zemmour et de Marine Le Pen. L’un incarne la radicalité intellectuelle, l’autre la prudence électorale. Comme Robinson, Zemmour s’acharne à poser des questions brûlantes, à dire l’indicible, à faire trembler le consensus. Comme Farage, Marine Le Pen choisit la voie du compromis, ménageant l’opinion, soucieuse d’apparaître « gouvernable ». Les deux trajectoires sont parallèles et parfois même complémentaires, au prix de tensions qui ne cessent de nourrir l’incertitude politique française.
La comparaison, cependant, trouve vite ses limites. Marine Le Pen ne possède pas de colonne vertébrale idéologique, elle épouse au contraire les idées majoritaires que les médias imposent, se faisant l’écho d’un prêt-à-penser destiné à rassurer. Le vide de sa vie personnelle reflète ce manque de convictions. Le choix de ses proches, tels Jean-Philippe Tanguy ou Sébastien Chenu, en dit long : elle ne s’entoure pas de penseurs, ni même de bâtisseurs, mais de gestionnaires opportunistes qui ne cherchent pas à se porter charnellement dans le futur. Rien, chez elle ni chez eux ne traduit une vision civilisationnelle à défendre ni encore moins à incarner.
À l’inverse, Marion Maréchal, en dépit de ses faiblesses de caractère, apparaît bien plus structurée. Elle sait pour quelles valeurs elle se bat, possède une colonne doctrinale claire et, sans chercher à complaire au goût du jour, inscrit son discours dans une perspective historique et culturelle. Là où Marine se contente de surfer sur la vague de l’opinion, Marion se place dans la continuité d’un héritage à préserver et d’un avenir à tracer. Entre la plasticité sans principe et la fidélité à des valeurs, la différence est de taille, et elle pourrait peser lourd dans les années à venir.
Toutefois, le véritable penseur, le véritable créateur idéologique, c’est Éric Zemmour. C’est lui qui a libéré la parole, qui a fissuré le mur de la censure intellectuelle en osant nommer ce que nul autre n’osait dire. Il a rouvert les portes fermées de la pensée française, rappelant la primauté de l’histoire et des racines, redonnant aux mots bannis, identité, civilisation, continuité, leur charge de vérité. Son rôle fut celui d’un éclaireur, non d’un suiveur. Il ne lui reste qu’à approfondir davantage cette vision identitaire de la France, à l’assumer pleinement, pour incarner vraiment l’homme providentiel dont le pays a besoin.
North n’exclut pas un tel retournement en Grande-Bretagne. Il envisage un scénario où Reform, arrivé au pouvoir, se révélerait un désastre. Alors « une figure comme Tommy Robinson pourrait surgir », se présentant en restaurateur d’ordre face au chaos. La politique anglaise a connu, jadis, des tournants de cette nature, lorsque la grève générale de 1926 fit craindre au gouvernement une véritable révolution, tanks et soldats déployés dans les rues de Londres. L’hypothèse d’une nouvelle fracture, sur fond de tensions ethniques et d’émeutes de rue, n’est pas pour North une chimère.
Je relis ces lignes avec le sentiment de voir se rejouer, en d’autres habits, le vieux drame européen décrit par Oswald Spengler : celui des démocraties fatiguées, épuisées par le bavardage parlementaire, qui finissent par faire appel à un homme providentiel. Non pas le génie réformateur, mais le chef énergique, celui qui surgit quand tout chancelle et qui, par la seule force de sa présence, infléchit le destin. L’Angleterre a produit jadis un Cromwell ou un Churchill, demain, qui sait, un Robinson ou un autre viendra occuper ce rôle. Les nations, disait Ernst Jünger, sont parfois sauvées par « l’homme de la décision » quand le corps politique est paralysé. C’est cette possibilité, redoutable et fascinante, que la crise britannique comme la nôtre semble désormais laisser entrevoir.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées
Crédit photo : DR
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine..



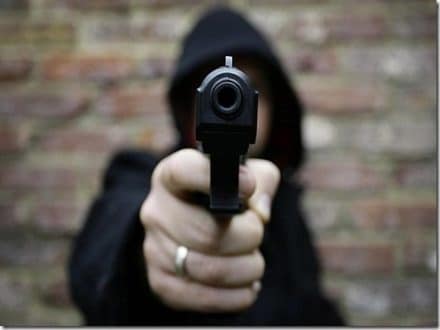

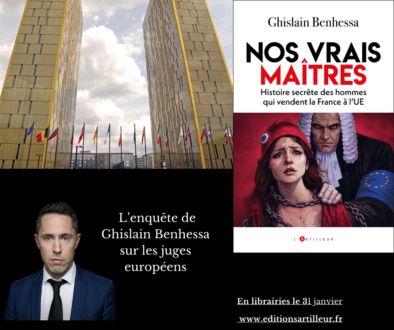








3 réponses à “Que fera Tommy Robinson de son succès ?”
Eric zemmour est clairement l’homme de la situation.
S’il a fini en Angleterre, qu’il vienne en France !
Votre commentaire sur MLP est juste !
Vous avez oublié Sarah Knafo qui a du fond et qui contrairement a Marion Maréchal travaille , voir ces contributions a l Europe !