J’étais dans ma cuisine, en train de préparer des encornets achetés chez Furic, le mareyeur du port du Guilvinec. Je les ouvrais un à un, retirant la fine plume translucide qui leur donne leur raideur, puis les yeux, puis les viscères, ce petit travail d’orfèvre qu’on fait à la table, sous la lampe, quand la mer sent encore sur les mains. Par la magie du téléphone, une voix me lisait un article du Figaro signé Élisabeth Pierson, intitulé « Loin du front, la bataille silencieuse des livres en Ukraine ». Et tout en épluchant mes encornets, mes mains noires de manipuler leurs entrailles, je songeais à cette étrange alliance du sang et de l’encre, de la guerre et du livre.

L’article racontait comment, dans une Kiev meurtrie, les librairies bourgeonnent comme des refuges. Là, entre deux sirènes, des jeunes gens achètent des poèmes, des récits, des essais qui leur parlent de ce qu’ils vivent. Les Ukrainiens lisent pour tenir debout. Et cette résistance littéraire s’accompagne d’une rupture : la langue russe, jadis omniprésente, se retire peu à peu du paysage. Les éditeurs n’impriment plus qu’en ukrainien, les bibliothèques se vident de leurs volumes russes, les écrivains eux-mêmes abandonnent la langue qu’ils ont apprise sur les genoux de leur mère pour celle, nationale, qu’ils veulent défendre.
Cette guerre n’est donc pas seulement une affaire de tranchées, mais de dictionnaires. Elle oppose deux alphabets, deux mémoires. Le cyrillique, alphabet de l’empire, se voit menacé par le romain, alphabet de l’Europe. Si l’Ukraine franchit ce pas, elle effacera la dernière ombre d’un monde partagé avec la Russie. Ce serait, pour reprendre une image marine, la rupture des amarres.
Tout en rinçant mes encornets sous l’eau claire, je me souvenais de la tragédie linguistique d’un autre peuple, celui des Philippines. Jusqu’aux années 1950, l’espagnol y était la langue des présidents, des journaux, des poètes. Puis, au nom du progrès, l’archipel passa à l’anglais, effaçant en une génération toute la part ibérique de son âme. Aujourd’hui, un jeune Philippin ne peut plus lire les lettres de ses grands-parents ni comprendre les discours de ses présidents d’avant 1950. C’est un pays orphelin de sa langue.
Je crains que l’Ukraine, dans son effort de renaissance, ne connaisse à son tour cette coupure du souvenir. Le russe fut l’instrument d’une domination, certes, mais aussi le véhicule d’une immense culture. On ne raye pas impunément Tolstoï, Pouchkine ou Tchekhov. Effacer leur langue, c’est effacer une part de soi. L’écrivain Myroslav Laiku, cité dans l’article, le sait bien : il a choisi d’écrire désormais en ukrainien, tout en confessant qu’il ne le maîtrise pas encore assez pour lire un journal sans effort. Sa conversion linguistique est une aventure spirituelle, non une mutilation.
D’autres avant lui ont connu ce déchirement fécond. Joseph Conrad, né Józef Teodor Konrad Korzeniowski, écrivit d’abord en polonais, puis en français, avant de trouver dans l’anglais la clarté qui convenait à son âme navigante. Beckett abandonna l’anglais pour écrire en français, par dépouillement ; Cioran quitta le roumain pour le français, par amour de la concision ; Kundera finit lui aussi par adopter la langue de ses lecteurs exilés. Quant à Nabokov, il les embrassa toutes trois, passant du russe à l’anglais avec une virtuosité de caméléon.
La langue est un navire. Certains y naissent, d’autres y embarquent plus tard, quand le vent tourne ou que la mer change de nom. On y transporte ses mythes, ses blessures, ses manières de dire la joie ou la mort. Chaque idiome a son génie propre : le français, sa précision, sa lumière réfléchie ; l’espagnol, sa chair, son sel, sa ferveur.
Je comprends ces migrations, car ma propre langue maternelle est l’espagnol. C’est dans cette langue que j’ai appris à penser, à prier, à jurer. Puis, en changeant de continent, j’ai changé de langue. Le français s’est imposé comme un autre rivage, un lieu de lenteur et de mesure, sans effacer la voix du premier. J’écris aujourd’hui dans les deux langues, passant de l’une à l’autre comme on traverse un détroit familier. Chacune éclaire l’autre, comme deux phares qui se répondent.
Les peuples, eux aussi, changent de langue comme on change de cap. L’Ukraine lave la sienne à grande eau, espérant y retrouver sa pureté première. Mais il faut souhaiter que ce nettoyage soit un renouveau, non une amnésie. Car le livre, au bout du compte, est le seul champ de bataille où la victoire ne se mesure pas en morts, mais en mots.
Et tandis que mes encornets cuisaient doucement dans la marmite, je songeais que ces munitions-là, au moins, ne tuent pas.
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



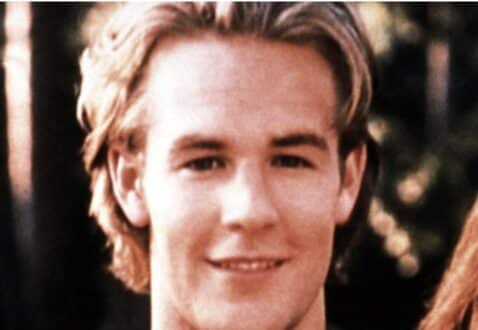


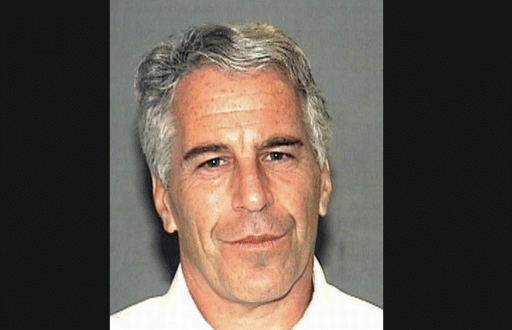







6 réponses à “Les encornets de la mémoire et guerre des livres en Ukraine”
La conquête d’un pays ne se fait pas seulement avec des armes; La Gaule , avec l’invasion romaine , en est l’exemple type; dans ce cas , sans doute, cela nous a été profitable.
Bel article sur les langues, les mots ! Merci !!!
Dire que Tolstoï parlait le russe et le français. A la fin du 18 sciecle l’aristocratie Russe parlais couramment le français. Même dans les noms était souvent français . Dans guerre et paix de Tolstoï les personnes de Pierre et André sont des personnages de premier plan. Aujourd’hui l’Ukraine est le système de gouvernement a et hacker par les ukronazi Nazi leurs fin est proche. Ce n’es pas une invasion par la Russie c’est bien une intervention spéciale. Il y a 3 objectif. Libérer les russophone de la vengeance de Kiev détruire tout l’arcenal militaire de Kiev et de l’OTAN. La denzification du territoire libéré que la paix soit le choix des deux parties. l’Ukraine n’existe plus
Et j’ajoute à propos des langues, le breton apporte sa solidité granitique de langue ancestrale caressée par le vent salé à Léchiagat, burinée par les embruns! Mais d’après Volkoff c’est la langue française qui est la plus riche de nuances. Puisque la tempête Claudia passe au large n’oublions pas un écrivain brésilien: » Quando minha prima Claudia morreu fiquei com uma imensa tristeza! ». Bon ces encornets on les prépare comment avant de déclencher un mouvement d’humeur de…
Présentation de notre honorable intello sur X : « libertarien indépendant libre retraité artiste multidisciplinaire inconnu heureux et fier d’être célibataire sans enfants Gaspésie et baie des chaleurs mexicœur ». Ah ! Surtout, restez inconnu, et si possible muet, Marcel !
Je suis largué par la science littéraire des Balbino, Raymond, et pourtant j’aime les belles lettres.
Il est vrai que mon dada se situe plutôt dans les Maths-technique.
Pas facile d’être à la fois matheux, littéraire et philosophe bref encyclopédiste comme Diderot, Albert Le Grand ou Blaise Pascal.