Il est rare que les historiens anglais s’attardent sur leurs échecs et, quand ils le font, c’est du bout des lèvres, à la manière d’un gentleman pris en faute, qui s’excuse sans baisser les yeux. Rien, ou presque, sur l’expédition de 1741 à Cartagena de Indias, où l’amiral Vernon, flanqué de deux cents navires et trente mille hommes, s’échoua contre la ténacité d’un Espagnol perclus, Don Blas de Lezo, qui, bien que manchot, borgne et estropié, infligea aux Anglais une correction impérissable. L’affaire de Buenos Aires, en 1806 puis 1807, où les milices du cru mirent en déroute les troupes de Sa Majesté, n’a reçu qu’un traitement discret dans les annales britanniques. Quant à la chute de Singapour, en 1942, elle fut généreusement imputée aux Australiens, ces rudes héritiers du bagne, réputés indisciplinés, presque barbares, comme si la faute revenait toujours aux plus mal peignés du lot, jamais à Whitehall.
Dans cet océan d’omissions et de pudeurs, l’œuvre de John Charmley tient de l’acte de bravoure. Il vient de quitter ce monde à l’âge de soixante-neuf ans, emportant avec lui un certain goût du panache et de la dissidence. Cet universitaire au nœud papillon insolent s’était donné pour tâche de déboulonner le mythe national par excellence : Winston Churchill, Saint Georges en tweed, fumeur de havanes et pourfendeur de dragons.
Son ouvrage Churchill: The End of Glory, publié en 1993, provoqua à Londres un frémissement de rage et de stupeur. Charmley y soutenait que l’homme du 18 juin britannique avait sacrifié l’empire sur l’autel de ses alliances, dilapidé les ressources de la nation dans une guerre qu’il aurait mal conduite, et laissé Washington et Moscou se partager le monde pendant que Westminster comptait les cuillères d’argent. Le Royaume-Uni, disait-il, entra dans le conflit pour empêcher l’Europe de tomber sous la botte allemande, et la vit finir divisée entre les chars soviétiques et le dollar. Beau résultat.
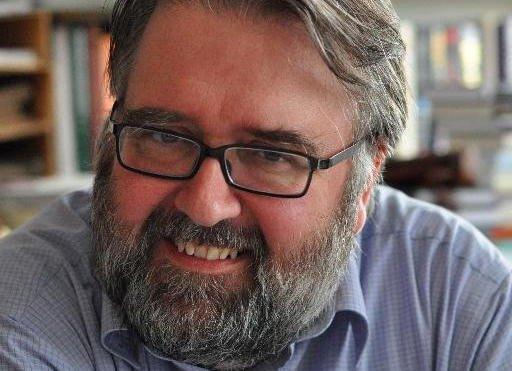
Charmley ne s’en tenait pas là. Il attaquait Churchill sur son propre terrain : l’écriture de l’histoire. Comme De Gaulle, Churchill ne fut pas seulement acteur du siècle, il en fut le scénariste, le metteur en scène et le narrateur. À coups de mémoires rédigées avec la ruse du vieux lion, il imposa sa version des faits, glorieuse, visionnaire, toujours providentielle. Ce récit hégémonique, John Charmley s’acharna à en montrer les failles, les angles morts, les intérêts.
Son entreprise n’était pas celle d’un pamphlétaire, mais d’un réaliste. Dans la lignée d’un Carl Schmitt, qu’il n’avait peut-être pas lus mais dont il partageait l’intuition stratégique, il voyait dans les choix churchilliens non un sursaut moral, mais une déroute géopolitique. La guerre froide était inscrite dès Yalta, non comme une fatalité, mais comme le fruit d’une abdication.
Ses autres ouvrages, Churchill’s Grand Alliance, Splendid Isolation?, ou encore son plaidoyer pour la non-intervention britannique en 1914, prolongeaient cette ligne claire : le Royaume-Uni n’aurait jamais dû se mêler aux querelles continentales. La grandeur, pour Charmley, n’était pas dans le fracas des armes mais dans la retenue. Il ne croyait ni à l’Europe, ni aux pactes, ni aux engouements moraux ; il croyait à l’intérêt national froidement calculé. Une vision qui l’éloignait des romantiques, mais le rapprochait des cyniques clairvoyants.
Son engagement politique, conservateur, thatchérien, mordant, n’était pas un camouflage idéologique, mais un tempérament. Il raillait les imposteurs de son camp, réservant à Boris Johnson un mépris sans vernis. À ceux qui comparaient l’ex-maire de Londres à Churchill, il répondait par une grimace ou un éclat de rire. Il n’y a pas de plus cruel hommage, dans la bouche d’un Anglais, que le sarcasme poli.
Universitaire brillant, mais aussi administrateur rusé, il sut protéger des cohortes d’étudiants talentueux dans un monde académique encore engoncé. Il redistribuait les ressources, bousculait les hiérarchies, préférait l’élégance du geste à la pesanteur des règlements. Il portait le monde comme une veste un peu trop grande mais pleine de poches.
Son itinéraire religieux, lui, relevait de l’épopée. De la méthode méthodiste à l’anglicanisme « high church », jusqu’au catholicisme romain, il fit le tour des chapelles avant de revenir, au soir de sa vie, vers la version tout aussi anglaise qu’adultérée de la foi. Cette conversion finale à l’anglicanisme, sorte de retour au port après mille tempêtes, a de quoi surprendre : on ne rejoint pas le Titanic quand il s’apprête à lever l’ancre. Peut-être était-ce là un dernier pied de nez, une ultime ironie.
On ne saura jamais ce qu’il a dit à Dieu en montant les marches. On peut seulement supposer que ce fut bien tourné.
Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —
Photo d’illustration : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine














2 réponses à “John Charmley, le sceptique impérial”
Charmley cherche à établir la vérité des faits matériels, ce qui est la fonction d’un historien, mais en même temps un jeu dangereux car destructeur d’un récit national. Notez que le wokisme et le révisionnisme fonctionnent de la même manière.
Le cas de Churchill est intéressant. Bien entendu, il s’est attaché à décrire l’histoire à sa manière, comme tous les grands dirigeants. Mais décrire l’histoire, c’est aussi l’écrire, et ainsi naissent les récits nationaux, du moins chez tous les peuples occidentaux et pas seulement chez les Britanniques. Prenez le célèbre discours « We shall fight on the beaches » en juin 1940 (« Nous irons jusqu’au bout, nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers et les océans, nous nous battrons avec toujours plus de confiance ainsi qu’une force grandissante dans les airs, nous défendrons notre Île, [etc., etc.] nous ne nous rendrons jamais »). Quinze jours après le piteux rembarquement de Dunkerque, il fallait le faire ! Et un de ses collègues parlementaires raconte que Churchill aurait murmuré : « et nous nous battrons avec des tessons de bouteilles de bière, parce que c’est tout ce qui nous reste ». En fait non : il lui restait la parole, car avec ce discours il a peut-être changé le cours de la guerre en remobilisant des Britanniques prêts à demander la paix.
Morale de l’histoire : il faut écrire l’histoire avec beaucoup de relativisme.
Que serait de nos jours l’Europe si Churchill Prime Minister de la Grande Bretagen dès 1940 avait accepté le deal de Hitler: « Tu me laisses le continent européen et je te laisse ton Empire Colonial. »
Il est probable qu’Adolf dès lors vainqueur de l’URSS aurait créé une Europe de l’Atlantique à l’Oural voire Vladivostok….1ere puissance mondiale.
Churchill qui se voulait « Alexandre Le Grand » a refusé tant il craignait comme les USA une Europe dominatrice.
Résultat actuel, la dépouille de l’Europe ou ce qu’il en reste est livrée aux appétits des Empires actuels USA, Chine, Russie…Sans oublier le Tiers Monde !