Il est des morts qui ne se contentent pas de clore une existence et qui ouvrent, par la manière même dont elles surviennent, un chapitre plus vaste, plus sombre, plus révélateur. La disparition de Alain Orsoni appartient à cette catégorie rare et funeste. Abattu d’un tir à longue distance, en plein cimetière, alors qu’il assistait aux obsèques de sa mère, l’homme emporte avec lui une part de l’histoire corse contemporaine et laisse derrière lui une île contrainte de se regarder sans fard, sans les voiles commodes de l’indignation médiatique.
J’observe cela depuis la Bretagne, avec ce regard d’étranger durable, enraciné sans être indigène, familier sans être du sérail. J’ai des ancêtres corses issus de l’Île-Rousse, mais je ne suis allé dans cette île qu’une seule fois dans ma vie, mû par une curiosité presque intellectuelle, celle de comprendre ce que l’on nomme aujourd’hui le mouvement palatin. Je connais peu la Corse par le corps, mais suffisamment par l’esprit pour discerner ce qu’elle tolère encore, ce qu’elle accepte par lassitude, et ce qu’elle rejette obstinément. Ce que j’y vois désormais, c’est moins un conservatoire de traditions figées qu’un laboratoire politique et humain, souvent en avance sur un continent qui se croit moderne alors qu’il n’est bien souvent que fatigué.
Ce qui s’est produit à Vero ne relève ni de la vendetta ancienne ni même du règlement de comptes ordinaire. On n’avait jamais tué en Corse lors d’obsèques. Pas même aux heures les plus sombres des haines claniques. Le lieu, le moment, la précision du geste introduisent une rupture. Ils disent que quelque chose s’est déplacé, ou peut-être effondré. Tirer à longue distance, en plein jour, lors d’une cérémonie funéraire, suppose des compétences presque militaires, une logistique, un sang-froid qui excluent l’acte isolé. Ce geste ne parle pas le langage politique, il parle celui d’un monde où l’efficacité prime sur le symbole, où l’intimidation devient démonstration de puissance.
La trajectoire d’Alain Orsoni ne se laisse pas enfermer dans une seule catégorie. Fils d’un militant de l’Algérie française, il appartient à cette génération façonnée par les débris encore chauds de l’empire, par le ressentiment, par une certaine idée de l’honneur et de la fidélité. Il passe par le GUD, ce creuset brutal et idéologique où se sont forgés nombre de nationalistes français des années soixante-dix, avant que l’affaire d’Aléria ne l’arrime définitivement à la cause corse. Le nationalisme, chez lui, n’est pas un vernis. C’est une conversion, presque une religion de substitution, avec ses dogmes, ses fidélités, ses aveuglements.
Ceux qui l’ont connu parlent d’un homme hors cadre, d’une intelligence redoutable, d’un tempérament qui refusait les demi-teintes. Pascal Gannat, père de Jean-Eudes, l’a rappelé avec une sobriété douloureuse, qui vaut témoignage plus que commentaire : « Triste nouvelle. La Corse est devenue un pays de mafia. On n’a jamais assassiné en Corse lors d’obsèques, même dans les pires vendetta. J’avais croisé assez régulièrement Alain Orsoni dans ma prime jeunesse, avec et chez des amis communs à Paris. C’était déjà une personnalité hors du cadre social habituel. Plutôt un idéaliste que la vie a happé vers une forme de désespoir. » Cette phrase éclaire autant l’homme que son destin. Orsoni n’était pas un cynique. Il était de ceux que l’Histoire utilise, puis abandonne.
Son parcours épouse les métamorphoses du nationalisme corse. Le temps du FLNC, des clandestinités structurées, des hiérarchies internes, puis celui du Mouvement pour l’autodétermination, plus politique, plus exposé, plus vulnérable aussi. À mesure que le nationalisme entrait dans les institutions, qu’il gagnait les exécutifs régionaux, il perdait ce qui faisait sa raison d’être. La conquête du pouvoir n’a débouché sur aucune refondation. Elle a accouché d’une gestion molle, souvent alignée sur les modes idéologiques du continent, jusqu’à accepter sans résistance la dilution démographique, culturelle et religieuse de l’île.
La mort d’Orsoni agit comme un tirage de rideau. Elle clôt un cycle né à Aléria et achevé dans les fauteuils feutrés de l’Assemblée de Corse. Elle révèle aussi la porosité entre certaines familles issues du nationalisme historique et les logiques du banditisme organisé. Beaucoup y voient la victoire définitive des logiques mafieuses. J’y vois plutôt un moment de vérité. La violence n’a pas disparu de Corse, elle a simplement changé de visage.
La stupeur des anciens, Jo Peraldi, Pierre Poggioli, la sidération de l’abbé Roger-Dominique Polge, leurs mots lourds, presque incrédules, disent l’effondrement des vieux codes. Le respect des morts, la sacralité des obsèques, ces lignes rouges que l’on croyait intangibles, ont été franchies. La vieille garde pleure un monde qu’elle sent s’éloigner, non sans une culpabilité diffuse, celle de n’avoir pas su empêcher la dérive.
Face à cette mort, un silence retient l’attention, celui de Nicolas Battini et de la Mossa Palatina. Aucun communiqué, aucune émotion affichée. Ce mutisme en dit long. Il marque une rupture nette avec le nationalisme des années quatre-vingt, celui des ambiguïtés, des compromis, parfois des compromissions. Les Palatins semblent tirer une ligne claire entre ce qu’ils estiment être un nationalisme à refonder et un passé jugé irrémédiablement vicié. Le silence devient ici un langage politique.
Il faut accepter une idée dérangeante pour l’esprit moderne. La Corse est une terre où la violence existe encore, et ce n’est pas forcément un mal absolu. Elle rappelle cette vérité trumpienne que tout n’est pas soluble dans la gestion, le droit mou, les indignations rituelles. Carl Schmitt notait que le politique commence avec la désignation de l’ennemi. Une société qui ne connaît plus aucune forme de violence symbolique ou réelle devient un espace ouvert à toutes les prédations. La violence, lorsqu’elle n’est pas purement criminelle, rend des choses possibles. Elle fixe des limites. Elle oblige à choisir.
La mort d’Alain Orsoni ne réhabilite rien et ne justifie rien. Elle oblige à regarder en face la fin d’un monde et l’émergence d’un autre, plus dur, plus froid, peut-être plus cohérent. L’île poursuit son histoire, indifférente aux lamentations venues du continent. Ceux qui prétendent encore aimer la Corse devront accepter cette part sombre, non pour la célébrer, mais pour ne plus se mentir.
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
[email protected]
[cc] Article rédigé par la rédaction de breizh-info.com et relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par une intelligence artificielle.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention obligatoire et de lien do follow vers la source d’origine.










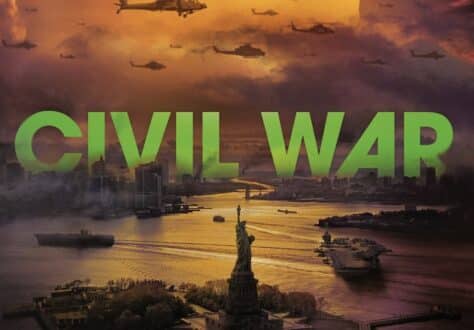



11 réponses à “De l’illusion institutionnelle à la violence nue, ce que dit la mort d’Alain Orsoni”
Que les Nationalistes Bretons rendent un vibrant hommage à Alain Orsoni. Les blablateurs wokistes de l »emsav » ne feront pas le quart du travail d’Orsoni. D’accord, les errements, le MPA, Casanova, mais quelle rigolade quand mon beauf me parle de ces années-là… Colonna, Orsoni, etc, la Corse change ou, quand le nationalisme meurt du wokisme mondialiste.
Bravo pour ce bel article, profond.
Qu’un philosémite compagnon de route de Riposte Laïque se permette de tirer la couverture à soi avec Alain Orsoni est choquant. Oui Alain Orsoni, notre camarade, c’est battu à Beyrouth conte les fedayins d’Arafat mais non pas pour défendre les juifs d’Israël mais les Chrétiens libanais. La récupération de la belle droite par les sionistes est une insulte à notre intelligence. Linvention des protestants américains d’un judéo-Christianisme.
Bonjour,
Là où vous voyez le sacrilège, je vois le respect. Ceux qui ont commandité l’assassinat ont attendu que sa mère meure. En tout cas, j’espère qu’ils l’ont conçu ainsi. Mais je suis d’un autre monde.
Cdt.
M.D
c’est tout simplement dégueulasse, de faire cet acte en plein deuil !! quoi que puisse avoir fait un homme (surtout qu’il ne faisait pas parti des plus mauvais) il y a un respect à avoir, bon vent monsieur Orsoni,vous serez certainement mieux compris la Haut !
Cela peut être aussi un meurtre commandité du continent ; dans la droite lignée des disparitions de Marleix ou Dénécé, non?
Avec l’assassinat d’Orsini on est loin , très loin de ce qu’accomplissaient les « bandits d’honneur » ou Colomba cette jeune héroïne de Mérimée réalisant religieusement sa vendetta.De nos jours ce sont surtout des règlements de compte mercantiles et de pouvoir.
Les codes d’honneur disparaissent peu à peu devant les nouvelles mafias, plus jeunes et les » actions politiques » qui ne s’encombrent pas des » règles ancestrales « . Avant, on respectait les vieux, les femmes, les enfants désormais ils sont devenus des cibles comme les autres pour faire peur….Avant on respectait les morts aux enterrements même avant de tuer plus tard…Quant aux » morts politiques », ce sont souvent des suicides ou des accidents bien organisés….Le respect et la parole donnée sont des pratiques révolues.
Excellent papier de M. Katz. Effectivement la violence n’est ni bonne ni mauvaise. Elle fait partie de la vie. C’est la brutalité barbare qui est mauvaise, une société « ouverte à toute les prédations ».
Question 1:
Si ce n’est pas dans les habitudes des corses… peut-on chercher l’ombre d’un faux drapeau ?
Question 2:
À qui profite le crime ?
Si personne ne revendique… pourquoi ne pas penser aux attentats de Bologne et de Milan, jamais revendiqués «mais faussement attribués aux brigades rouges – frappe ciblées, individuelle et jamais de bombes…
https://youtube.com/watch?v=IiMAHUZ_v8U&si=NNDKn1w5U_yUt0Z1
Mieux vaut préparer des filets de tacauds du Guilvinec dans une cuisine de la rue du Vivier à Léchiagat…(29) même s’il crachine dehors.