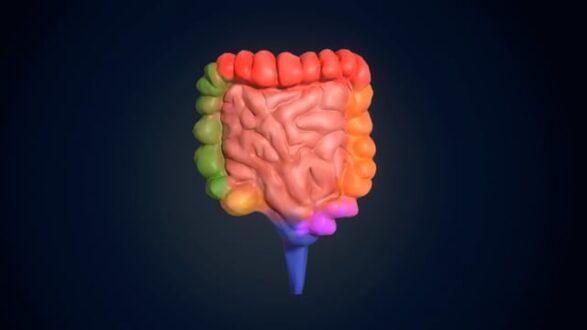Je longeais ce matin les rues tranquilles de Treffiagat. Le ciel avait cette pâleur de zinc que la côte connaît bien, quand l’hiver ne décide pas encore s’il doit mordre ou simplement peser. J’allais sans hâte, comme on marche ici, en suivant un trajet mille fois répété, puis le regard est happé par une présence immobile, le monument aux morts, dressé face à l’église, avec sa pierre grise et ses noms serrés comme une litanie, autrefois encadré par deux canons de 77 allemands ou autrichien aujourd’hui disparus. Rien de grandiose, rien d’emphatique, une liste, et pourtant tout y est, la chair devenue alphabet, la vie réduite au patronyme, la jeunesse arrêtée net.
Dans les communes du littoral, ces monuments ont une résonance particulière tout comme les plaques commémoratives pour les péris en mer. On les a vus enfant, on les retrouve adulte, et l’on comprend, avec les ans, qu’ils ne sont pas seulement des objets de mémoire, mais des avertissements. La mer apprend la prudence, la guerre apprend la gravité. Les deux ont en commun d’exiger du réel qu’il se rappelle à nous, sans consentir aux fictions.
Il est de bon ton, depuis plusieurs décennies, de parler de la guerre comme d’une anomalie morale, une régression, une pathologie de l’humanité. Cette vision, confortable, relève pourtant d’un contresens historique. La guerre n’a jamais été une parenthèse dans l’histoire des sociétés humaines, elle en fut longtemps la grammaire même. Elle réglait les conflits, redistribuait les puissances, tranchait ce que les palabres et les traités ne pouvaient résoudre. Les sociétés européennes, façonnées par des siècles de conflits armés, s’y sont structurées, parfois au prix du sang, souvent au bénéfice d’un ordre plus stable que celui qui l’avait précédé.
L’année 1945 introduisit cependant une rupture inédite. Pour la première fois, un ordre mondial se donna pour principe affiché l’abolition de la guerre comme instrument légitime des relations internationales. La Charte des Nations unies, adoptée à San Francisco avant même que les canons ne se taisent sur le continent européen, entérinait cette ambition. On ne devait plus faire la guerre, ou plutôt, on ne devait plus la nommer. La violence armée subsista, mais sous d’autres vocables, opérations de maintien de la paix, interventions humanitaires, actions de police internationale. La guerre entrait dans l’art, assez raffiné, de la dissimulation.
Cet ordre, que beaucoup prirent pour un progrès moral définitif, reposait en réalité sur un équilibre de forces très précis, celui issu de la victoire américaine et soviétique, puis figé par la dissuasion nucléaire. Il produisit une stabilité relative, mais aussi une hypocrisie structurante, la guerre continuait partout, sauf dans le langage officiel. On la menait sans la déclarer, on la gagnait sans la reconnaître, on la perdait sans jamais en assumer le coût politique.
L’un des effets les plus tangibles de la présidence de Donald Trump aura été de fissurer ce décor. Non par un pacifisme soudain, encore moins par une conversion à l’idéal européen, mais par un retour brutal au réel. Cet ordre mondial, fondé sur la fiction d’une paix permanente, disparaît de facto. Les rapports de force redeviennent lisibles, les alliances contingentes, les intérêts assumés. Cela choque les esprits élevés dans le catéchisme onusien, mais l’histoire n’en est pas émue.
La question cruciale demeure, sommes-nous prêts, en Europe, à ce monde qui revient. Rien n’est moins sûr. Les élites européennes, surtout celles qui gouvernent les petits États, vivent depuis plusieurs générations dans un bain transatlantique. Elles pensent en anglais, raisonnent selon des catégories importées, ont souvent été formées sur les campus américains et entretiennent un réseau relationnel qui rend presque impensable toute autonomie stratégique. Imaginer un ordre mondial où l’Europe ne serait pas fusionnelle avec les États-Unis leur est intellectuellement impossible. Nous sommes gouvernés, trop souvent, par des castrats politiques, au sens où ils ont perdu l’organe même de la décision, l’audace, le goût du risque, la capacité de vouloir.
Cette incapacité contraste avec la situation de la Russie ou de la Chine, dont les élites dirigeantes, pour le meilleur ou pour le pire, ne vivent pas dans ce régime de soumission idéologique. L’Europe, elle, demeure prisonnière d’une vassalité consentie, doublée d’un sentiment de culpabilité soigneusement entretenu. La Seconde Guerre mondiale, ses causes, son déroulement, ses conséquences, occupent dans l’imaginaire collectif une place telle que l’Europe se vit encore comme fautive par essence. Sa mise sous tutelle américaine devient alors non seulement acceptable, mais moralement justifiée, comme une pénitence prolongée. Par un singulier renversement, on nous persuade que l’obéissance est une forme de vertu, et que l’impuissance serait une sagesse.
Ce désarmement moral précède et accompagne le désarmement stratégique. Il prive le continent de tout système de valeurs capable de le protéger, notamment face aux dynamiques migratoires qui le transforment en profondeur. Devant le monument aux morts de Treffiagat, cette évidence s’impose avec une cruauté tranquille. Ces noms gravés dans la pierre appartiennent à un monde qui savait que la paix n’est jamais un état naturel, mais une construction fragile, toujours menacée. Oublier cette vérité, c’est s’exposer à la subir de nouveau, sans même disposer des mots pour la nommer.
De ce constat découle une seconde réflexion, plus sombre encore. L’Europe se retrouve projetée dans un monde nouveau auquel elle n’était préparée ni matériellement, ni militairement, ni économiquement, ni financièrement, et surtout pas mentalement. Ce défaut de préparation est particulièrement criant parmi nos élites politiques. Le continent fait face à des défis pour lesquels aucun réflexe historique récent n’existe plus. La guerre, que l’on croyait reléguée hors du continent, s’est installée durablement en Europe depuis 2022.
Ce conflit qui ravage l’Est de notre continent échappe à toutes les grilles de résolution mises en place depuis 1945. Durant plus d’uns siècle, la fin des guerres européennes passait, presque mécaniquement, par l’intervention massive d’une grande puissance extérieure. Or cette solution n’est plus disponible. L’arrivée au pouvoir de Donald Trump a conduit à une quasi-disparition du soutien américain à l’Ukraine. En 2026, l’aide militaire se limite à un flux résiduel de matériels déjà promis, tandis que l’aide financière, qui structurait l’effort ukrainien, s’est pratiquement tarie.
Si l’Ukraine résiste encore à la poussée russe, ce n’est donc ni par inertie ni par miracle. Elle le doit certes aux financements européens, devenus centraux dans la poursuite de l’effort, mais surtout à une capacité de résilience et d’adaptation qui force l’attention. La société ukrainienne, plongée sans interruption dans la guerre depuis 2022, a compensé le manque de moyens classiques par une innovation tactique constante. L’investissement massif dans les drones, l’automatisation croissante de certaines fonctions défensives, la robotisation partielle des lignes de front et l’adaptation permanente à la pénurie d’hommes ont profondément transformé la conduite des opérations. Il ne s’agit pas d’un modèle victorieux au sens ancien, celui des percées, des enveloppements et des redditions spectaculaires, mais d’un modèle de survie stratégique, capable de durer en l’absence de supériorité matérielle décisive.
La guerre s’installe ainsi dans une temporalité longue, sans capacité de rupture stratégique identifiable dans les semaines ou les mois à venir. Les lignes de front sont figées, et rien ne permet d’envisager une percée décisive dans un sens comme dans l’autre. Cette stabilisation apparente masque cependant un déplacement du centre de gravité du conflit.
Dans ce contexte, le combat décisif ne se déroule plus prioritairement sur la ligne de contact, mais à l’arrière. La Russie concentre un effort considérable sur le réseau énergétique ukrainien. Les effets sont lourds, Kiev et les grandes villes subissent des coupures massives d’électricité et de chauffage. Il serait pourtant erroné de croire que l’Ukraine présente une vulnérabilité moindre parce que sa production énergétique serait plus dispersée. Elle demeure, comme en Russie, relativement concentrée. Ce qui a changé, au fil des hivers, c’est le comportement des utilisateurs. Année après année, la société ukrainienne s’est adaptée aux coupures. Générateurs individuels ou collectifs, batteries domestiques, solutions de chauffage alternatives, réseaux de solidarité locale ont amorti l’impact des frappes. La résilience ne tient donc pas tant à l’infrastructure qu’à l’usage, non à la structure du système, mais à la plasticité sociale face à sa dégradation.
Les frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes existent, mais elles se heurtent à l’immensité du territoire adverse. L’impact est asymétrique. Cette asymétrie est renforcée par la structure même des économies en guerre. L’Ukraine importe l’essentiel de ses carburants raffinés, ce qui rend extrêmement difficile pour Moscou de la priver durablement de carburant. La Russie, en revanche, dépend de ses raffineries intérieures, et les frappes ukrainiennes de l’automne 2025 ont fait ressentir, pour la première fois dans certaines régions, les effets concrets de la guerre, lorsque des pénuries locales sont apparues.
L’histoire offre ici un parallèle instructif. Les campagnes de bombardement américaines contre le Nord-Vietnam furent longtemps inefficaces, précisément parce que ce pays ne produisait presque rien de ce qu’il consommait militairement. Tout changea en 1972 lorsque le président Nixon fit miner les ports nord-vietnamiens, coupant l’arrivée des approvisionnements. La guerre énergétique obéit aux mêmes lois, ce n’est pas le fracas qui décide, c’est la logistique, ce mot austère dont dépend la destinée des nations.
Si la réalité de la guerre est pleinement intégrée dans le mental de la société ukrainienne, immergée dans le conflit depuis 2022, il n’en va pas de même en Russie. Une part essentielle du contrat social entre le pouvoir et la population repose sur l’isolement de la vie quotidienne par rapport aux conséquences du front. Cette digue psychologique commence à se fissurer, mais l’expérience historique impose la prudence. Les destructions matérielles, en elles-mêmes, ne brisent pas les sociétés. L’Allemagne de la Seconde Guerre mondiale résista jusqu’au dernier jour, sous les bombes, mais le ventre plein. L’Allemagne de 1918, à l’inverse, s’effondra sans une seule bombe ennemie sur son sol, mais le ventre vide. Ce n’est pas la ruine qui abat les régimes, c’est la faim.
La perception de la guerre est en outre brouillée par un épais nuage de récits contradictoires. Il suffit de fréquenter les réseaux sociaux pour observer ce balancement fébrile. D’un côté, une narration ukrainienne et occidentale répétant que la Russie s’effondrera demain, que son économie est à l’agonie et que le régime vacille à chaque offensive. De l’autre, une propagande russe affirmant que la victoire est inéluctable, que le temps joue pour Moscou et que l’Ukraine ne survit que par perfusion artificielle. Ce théâtre d’ombres finit par imposer une alternative fausse, ou bien l’ennemi s’écroule, ou bien il triomphe, comme si la réalité ne pouvait être une longue usure, une décomposition lente, une victoire sans victoire.
Ce brouillard empêche de voir les conséquences de long terme déjà à l’œuvre. La catastrophe démographique ukrainienne est visible. Elle l’est aussi, à un degré moindre mais réel, en Russie. Ces deux grandes nations européennes se heurtent à un hiver démographique sévère, aggravé par un refus collectif d’en parler. Ne pas accepter la guerre dans le discours public interdit mécaniquement de prendre les mesures nécessaires pour en atténuer les effets, notamment en matière de natalité, d’organisation sociale et de projection à long terme. Le silence, ici, est une seconde défaite.
Pour la Russie, un chiffre symbolique a récemment circulé, glaçant. La durée de la guerre en Ukraine a désormais dépassé celle de la Grande Guerre patriotique. Autrement dit, les Soviétiques furent à Berlin en moins de jours que la Russie n’en a passé aujourd’hui à progresser de manière centimétrique sur le front ukrainien. Certes, l’aide américaine avait été déterminante en 1941-1945, et sans elle l’effort soviétique aurait été plus long et plus coûteux. Il n’en demeure pas moins que la force symbolique de cette comparaison pèse sur l’image de la puissance russe, et qu’une grande puissance humiliée, même sans défaite formelle, devient un objet de convoitise dans ses marges.
Cette dégradation m’inquiète, non par empathie, mais par lucidité géopolitique. Elle ouvre un espace dangereux en Sibérie, où le renforcement de la présence chinoise pourrait durablement modifier un équilibre hérité du XIXe siècle. Ce qui fut jadis une zone d’influence de Pékin avant l’expansion russe redevient un horizon stratégique incertain. On voit déjà, derrière la guerre européenne, le frémissement d’une autre histoire, plus vaste, plus froide, plus longue.
Ce scénario, d’un danger extrême, constitue pourtant une opportunité historique pour l’Europe. Encore faudrait-il qu’elle soit capable de penser politiquement, et non plus à l’intérieur des cadres intellectuels et juridiques figés de 1945. Carl Schmitt rappelait que l’ordre international n’est jamais qu’un ordre concret, adossé à des puissances réelles, et que le droit, si souvent invoqué, suit la force comme l’écume suit la vague. Nous avons voulu croire l’inverse, et l’on s’étonne maintenant que la marée remonte.
Je demeure sceptique face à la capacité des élites qui gouvernent aujourd’hui l’Europe à s’affranchir de deux entraves simultanées. La première est intellectuelle et stratégique, une dépendance presque réflexe aux cadres de pensée occidentaux et transatlantiques, qui interdit d’imaginer un monde où l’Europe agirait pour elle-même. La seconde est morale, un sentiment de culpabilité hérité de la Seconde Guerre mondiale, constamment ravivé, qui transforme toute affirmation de puissance européenne en soupçon, voire en faute. Tant que ces deux chaînes ne seront pas brisées ensemble, aucune liberté d’action réelle ne sera possible.
Dans l’attente d’une relève générationnelle, l’Europe devra accepter une part de risque, et le fait d’être seule sur l’arène politique mondiale. Avoir pris le relais du soutien à l’Ukraine fut une première étape. Le constater ne signifie pas l’approuver. Il s’agit d’un fait, et ce fait constitue, qu’on le veuille ou non, une preuve involontaire de puissance. L’Europe a montré qu’elle pouvait soutenir un effort de guerre de haute intensité sans l’appui direct des États-Unis, ce qui aurait été jugé impensable quelques années plus tôt. La politique a parfois des ironies cruelles, on découvre sa force au moment même où l’on doute de sa légitimité.
Réagir aux menaces américaines sur le Groenland, même par des gestes symboliques, en serait une seconde. Car si l’on reprend l’argumentaire américain, toutes les possessions ultramarines européennes deviennent des cibles potentielles. Les justifications avancées pour le Groenland pourraient demain s’appliquer à la Guyane française. L’Europe s’étonnerait alors, comme un homme surpris dans son sommeil, qu’on puisse lui parler le langage même qu’elle s’est habituée à entendre ailleurs.
Je demeure sceptique face à la capacité des élites actuellement au pouvoir à accomplir ce déplacement mental et politique. Elles ont été formées dans un monde clos, celui de l’après-1945, où la paix était supposée définitive, où le droit devait primer la force, où l’histoire était tenue pour achevée. Leur univers mental est celui des traités, des sommets, des communiqués rédigés en anglais, des valeurs proclamées plus que vécues. Elles sont incapables non seulement d’agir autrement, mais même de penser autrement. Pour elles, toute affirmation de puissance européenne demeure suspecte, et toute autonomie stratégique prend les allures d’une faute morale.
Pourtant, un frémissement existe. Il serait malhonnête de ne pas le voir. Une nouvelle génération de responsables politiques émerge, principalement à droite, encore minoritaire, souvent marginalisée, mais intellectuellement mieux armée que ses devancières. Elle n’a pas grandi dans l’illusion d’un monde pacifié par le droit, mais dans celui des crises successives, effondrement des frontières, désordre migratoire, insécurité massive, ensauvagement de nos sociétés, islamisation galopante, retour de la guerre sur le continent, brutalisation générale des relations internationales. Elle ne raisonne plus à partir des rêves iréniques de San Francisco, mais à partir du réel, tel qu’il s’impose, rugueux, instable, parfois brutal.
Ces responsables, qu’ils en aient pleinement conscience ou non, sont bien davantage les héritiers politiques de la Nouvelle Droite que les enfants dociles de l’idéologie onusienne. Ils ont été formés, directement ou par capillarité, à une pensée qui n’élude ni le tragique ni la conflictualité du monde. Guillaume Faye parlait d’un retour du tragique et d’une convergence des catastrophes. Ce que beaucoup prenaient pour une provocation intellectuelle ressemble aujourd’hui à une description méthodique de notre présent.
Ce qui distingue surtout cette génération, c’est qu’elle a pleinement conscience du péril démographique et identitaire. Là où ses aînés persistent à nier, à relativiser ou à disqualifier moralement toute inquiétude, elle regarde les chiffres, les territoires, les transformations anthropologiques en cours. Pour elle, le Grand remplacement n’est pas un mythe commode ni une construction fantasmatique, mais une dynamique observable, aux causes multiples, aux effets déjà visibles, et dont la poursuite menace directement la continuité historique des peuples européens. Il ne s’agit pas d’une obsession idéologique, mais d’une question de survie civilisationnelle.
Cette génération ne croit plus que l’effacement protège, ni que la repentance désarme l’adversité. Elle sait que la guerre n’est pas seulement militaire, mais aussi démographique, culturelle, symbolique. Elle comprend que l’autonomie stratégique n’a aucun sens sans continuité humaine, et que la souveraineté politique devient un mot creux lorsqu’un peuple cesse de se reproduire, de se transmettre, de se reconnaître. Là encore, il ne s’agit pas d’un appel à la haine, mais d’un constat froid, presque clinique, que les discours officiels s’acharnent à masquer.
Rien n’est gagné. Cette génération est encore entravée par des institutions conçues pour neutraliser toute décision forte, combattue par un appareil médiatique fidèle au monde d’hier, soupçonnée dès qu’elle nomme les choses. Elle commettra des erreurs, sans doute. Elle sera parfois maladroite, parfois excessive. Mais elle possède une qualité devenue rare, elle accepte de regarder le réel sans fard, et d’en tirer des conséquences politiques, là où d’autres se réfugient dans l’incantation morale.
En passant devant le monument aux morts de Treffiagat, je me dis que ces pierres muettes en savent plus long que bien des traités. Elles rappellent que l’Europe ne s’est jamais maintenue par le déni, mais par la conscience aiguë de ce qu’elle est et de ce qu’elle risque de perdre. Un continent qui refuse de penser la guerre se condamne à la subir. Un continent qui refuse de penser sa disparition se condamne à l’organiser. Celui qui accepte à nouveau le tragique, militaire, démographique, identitaire, peut encore espérer retrouver le sens de sa liberté. Ce n’est pas une promesse. C’est une possibilité. Et dans le monde qui vient, les possibilités sont déjà des actes en puissance.
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
[email protected]
Photo d’illustration : DR
[cc] Article rédigé par la rédaction de breizh-info.com et relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par une intelligence artificielle.
Breizh-info.com, 2026, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention obligatoire et de lien do follow vers la source d’origine.